


Didier
SCHEIN
Mars 2002
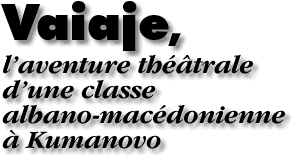
![]() orvan Benoist a été engagé par le Centre Culturel de Skopje pour créer à Kumanovo la seule classe mixte albano-macédonienne de Macédoine. Avec ces élèves, il a monté "Ubu roi" d’Alfred Jarry : la troupe, nommée "Vaiaje", a gagné le festival de théâtre amateur francophone de Skopje en avril 2001. Cinq jours plus tard, autour de Kumanovo, la guerre éclatait entre communautés albanaise et macédonienne. Morvan Benoist nous raconte l’aventure de cette classe multi-ethnique…
orvan Benoist a été engagé par le Centre Culturel de Skopje pour créer à Kumanovo la seule classe mixte albano-macédonienne de Macédoine. Avec ces élèves, il a monté "Ubu roi" d’Alfred Jarry : la troupe, nommée "Vaiaje", a gagné le festival de théâtre amateur francophone de Skopje en avril 2001. Cinq jours plus tard, autour de Kumanovo, la guerre éclatait entre communautés albanaise et macédonienne. Morvan Benoist nous raconte l’aventure de cette classe multi-ethnique…
L’Un Est L’Autre : Pouvez-vous nous présenter Kumanovo, la ville où vous travaillez ? Quelles sont les différentes communautés ethniques qui y habitent et quels sont les liens qui existent entre elles ?
Morvan Benoist : Kumanovo est la 4e ville de Macédoine, après Skopje la capitale, Bitola au sud et Tétovo à l’est. C’est une ville de 80 000 habitants intra-muros et 120 000 habitants en prenant les villages environnants. Cette ville, située au nord-est, est à 10 km de la frontière serbe, 15 km du Kosovo et 60 de la frontière bulgare, elle est donc un carrefour important de personnes et de marchandises en tout genre. Elle représente donc une sorte de ville tampon entre plusieurs milieux communautaires. Cette ville est donc de ce fait, une des villes les plus mélangées de Macédoine. La majorité de la population est formée de Macédoniens (45%), qui sont des slaves. La première minorité est la minorité albanaise qui doit représenter 30% de la population, ensuite viennent deux communautés à niveau égal, la communauté serbe et la communauté rom, chacune environ à hauteur de 10 % de la population. Bien sûr comme dans toutes les villes des Balkans, d’autres communautés existent comme les Torbesh (macédoniens islamisés), les Turcs, les Aroumains parlant une langue romane, "cousins lointains" des Roumain…
Les liens entre les Macédoniens et les Serbes sont réels, les deux communautés s’apprécient et formaient il y a peu la Yougoslavie, il se considèrent commes des cousins.
La communauté albanaise, quand à elle, entretient des relations conflictuelles avec les deux communautés slaves. Une séparation spatiale existe dans la ville, même si elle n’est pas matérialisée par un mur et qu’elle est assez leste, on peut rapidement se rendre compte si nous sommes dans un quartier à peuplement albanais ou un quartier à peuplement macédonien. Certains quartiers sont "mixtes", mais en fait ils représentent les zones de contact entre deux quartiers communautaires.
La communauté rom, quand à elle, vit abandonnée à elle-même et semble accepter cet état de fait avec un fatalisme étonnant. Leurs conditions de vie sont semblables à celles des brésiliens des favellas, bidonvilles, le soleil en moins, et leur intérêt social est d’être les "rats" de l’économie de Macédoine, ils ont droit aux restes quand il y en a, poubelles…
"Les professeurs des deux communautés et tout le monde me promettait bien du courage et pensait que cette classe ne fonctionnerait pas."
L’Un Est L’Autre : D’où est venue l’idée de créer une classe bilingue à Kumanovo ?
Morvan Benoist : L’idée est venue du Centre Culturel Français de Skopje, satellite culturel et linguistique de l’Ambassade de France en Macédoine, qui dans une politique de relance du français dans les pays ex-communistes, a lancé un programme de classes bilingue en Macédoine. Ce système se substitue aux anciens programmes de lycée français, trop onéreux, en utilisant les lycées du pays et en proposant un partenariat, où un lecteur français est dépéché afin de monter une section bilingue. Ces sections fonctionnent avec des professeurs du pays, qui dispensent leurs matières, à Kumanovo (mathématique, physique, chimie, biologie et littérature), après avoir été formé à la langue française, un an de formation linguistique et des stages de formation linguistique en France.
A Kumanovo le projet du Centre Culturel était de créer deux classes bilingues, une macédonienne et une albanaise, avec le but lointain de les réunir au niveau de la troisième année de lycée (en Macédoine le lycée compte 4 années et non 3 comme en France), après deux ans de travail séparé.
Après quelques semaines dans la ville, j’ai proposé au Centre de ne faire qu’une classe bilingue, mais de la faire mixte directement, car il me paraissait bien improbable vu la haine cordiale qui lie ces deux communautés qu’après deux ans de travail séparé ils acceptent de se mélanger. De même, il fallait insister sur le fait que nous n’étions pas en mesure d’avoir deux classes bilingues, du fait du problème humain et matériel, ce qui était de plus la vérité, car personne réellement au début, ne tenait à cette classe mixte, et tout le monde préférait des classes séparées. Pour me faire adhérer à leurs vues, les professeurs des deux communautés et tout le monde me promettait bien du courage et pensait que cette classe ne fonctionnerait pas.
L’Un Est L’Autre : Comment l’ouverture de cette classe a-t-elle été perçue par les habitants des communautés macédoniennes et albanaises de Kumanovo ?
Morvan Benoist : Je dois dire que j’ai toujours fait très attention à me placer à l’ "orée du bois" entre les deux communautés afin de tenter de réussir le travail qui m’avait été confié, monter la seule classe en Macédoine où des élèves des deux communautés les plus en conflit, devaient travailler ensemble. J’ai eu un an pour prouver à mes différents interlocuteurs, directeurs d’école (lycée et collège où j’allais présenter le projet pour l’inscription d’élèves), professeurs du projet et professeurs hors du projet, ainsi que toutes les personnes que j’ai pu rencontrer, que je ne me plaçais pas dans une logique communautaire, mais que cette classe fonctionnerait avec tous les élèves du lycée "Goce Delcev", école dans laquelle étudiaient de manière séparée, des Macédoniens et des Albanais. J’ai dans ce cadre été le cristallisateur de toutes les peurs des populations. A mon arrivée, le Centre Culturel Français avait, pour m’épauler dans ma prise de contact avec ce nouvel environnement investi une personne de co-responsable de la classe bilingue. Il s’est avéré que cette personne sabotait consciemment ou inconsciemment toutes possibilités de travail avec la communauté albanaise, par un état d’esprit autoritaire et exclusif. Les professeurs albanais se sont donc retirés du projet et m’ont donné comme explication que de tout temps la France avait de bonnes relations avec les Serbes et les Slaves en général et que cela prouvait que ce projet n’était pas pour eux. J’ai donc dû à ce moment-là, aller "à la pêche" aux professeurs albanais afin de sauver ce projet. Les professeurs macédoniens quand à eux, au début, me voyaient plutôt d’un bon œil, mais ma volonté réaffirmée de travailler avec tous et sans discriminations d’aucune sorte à commencé à troubler leur relative confiance. Assez rapidemment, j’ai senti une méfiance de leur part, puis un désintérêt du projet et ensuite une sorte d’indifférence affichée. Par exemple certains professeurs que je salue respectueusement depuis maintenant deux ans et demi, affichent encore cette volonté de ne pas me répondre et de passer à côté de moi comme si je n’existais pas.
Au niveau des habitants, je dois dire que l’impression que j’ai eu est que les parents des élèves étaient sceptiques sur la mixité, mais en même temps conscient de l’intérêt pour leurs enfants à apprendre une langue étrangère avec un natif et à rentrer dans un projet qui promet à leurs enfants de pouvoir s’inscrire dans une faculté française à l’égal d’un élève français.
" Un élève, même si il est étrange pour lui de se retrouver avec des élèves de la communauté voisine qu’il déteste, ne va pas forcément faire un rejet et semble curieux de voir ce qui va se passer. "
L’Un Est L’Autre : De quelles façons les élèves ont-ils été "inscrits" dans la classe ? Était-ce leur choix, celui des parents… ? Avez-vous eu beaucoup de demandes ?
Morvan Benoist : Afin de faire connaître ce projet, j’ai au cours de ma première année sur Kumanovo, fait le tour des collèges et expliqué aux directeurs des établissements le projet, rencontré le maximum de professeurs de français afin qu’ils soient mes relais dans les différentes écoles et diffusé, par le biais des télévisions locales, des clips de publicité.
Il est toujours très difficile de savoir qui décide, mais quand je me souviens des inscriptions et des premiers cours de la classe bilingue de la première génération, je peux assurer qu’aucun élève ne semble être venu dans la classe bilingue contre son gré.
En général et le reste de cette interview le prouvera, je trouve ici en Macédoine les élèves beaucoup moins bloqués que leurs parents dans leur mode de fonctionnement cérébral. Un élève, même si il est étrange pour lui de se retrouver avec des élèves de la communauté voisine qu’il déteste, ne va pas forcément faire un rejet et semble curieux de voir ce qui va se passer. Les adultes, au premier lieu desquels les professeurs sont eux complètement bloqués et diffusent même par leur manière d’être un rejet de l’autre palpable, qui forcément contribue auprès des enfants dont ils ont en charge l’éducation, à développer encore s’il en était besoin, la méfiance et la haine entre ces deux communautés.
L’Un Est L’Autre : Vous travaillez avec les élèves de votre classe la mise en scène de "Ubu roi" d’Alfred Jarry. Pourquoi Ubu ? Qu’est-ce qui a motivé le choix du spectacle ?
Morvan Benoist : Le choix est totalement subjectif et c’est le mien. J’ai cherché des pièces de théâtre en français, qu’elles soient écrites où non par un français, afin de faire créer à un petit groupe d’élèves motivés quelque chose entre eux.
Ma connaissance théâtrale est très légère, mais il m’a semblé très difficile de trouver des pièces pouvant parler de thèmes les plus profonds soient-ils mais avec un comique enracinée dans la pièce, un ridicule permettant à des élèves non-natifs de pouvoir s’amuser avec la langue française.
C’est un point de vue très personnel mais dans ma conception, le théâtre est un jeu, et le jeu est par définition vivant. Il doit donc y avoir du tragique, mais un bonne part de comique et une relative ouverture du texte afin de donner aux élèves un espace d’improvisation. Le ridicule est aussi de ce point de vue un ressort du théâtre très intéressant.
Bref, Ubu est à cet effet une pièce très bien construite, car elle offre une liberté totale au jeu, elle permet aussi une souplesse au niveau du langage incroyable. J’ai d’ailleurs eu cette année beaucoup de mal à trouver des pièces qui me satisfont autant. (Si vous connaissez des œuvres, n’hesitez pas, ce sera votre contribution…)
L’Un Est L’Autre : Comment la culture française est-elle perçue en Macédoine ? A-t-elle un écho important ?
Morvan Benoist : La culture française revêt un aspect vieillot en Macédoine (Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Mireille Matthieu…), et même si cette image commence à évoluer (Taxi, Astérix et Obélix, Zazie…) elle reste loin de représenter le "dynamisme" d’une culture anglo-saxonne ou américaine omniprésente.
La France représente LE pays de la culture, ce qui n’est en fait pas une si bonne chose que ça. Car nous représentons un peu ici une image figée de la culture, Paris, la tour Eiffel, la mode, les cuisses de grenouille…Par contre au niveau du dynamisme culturel nous devons représenter dans l’esprit du jeune macédonien avide de nouveautés à peu près ce que peut représenter pour nous le dynamisme culturel autrichien…

L’Un Est L’Autre : Pour les acteurs, que représente le personnage d’Ubu ?
Morvan Benoist : A vrai dire, je n’ai jamais parlé réellement avec les élèves de ce qu’ils comprennaient de cette pièce, car ici tout peut très vite se rapporter à la politique et mon but visait l’inverse, fédérer des jeunes de communautés différentes à la lisière de la guerre, à monter un spectacle traitant de la comédie tragique qu’est la vie.
Mais, certains Français que nous n’avons pas pu éviter, ont bien évidemment demandé à mes élèves s’ils comprenaient ce qu’ils jouaient…
Et leurs réponses du reste assez évasive, du fait de l’intelligence de la question posée, m’ont laissé comprendre que le père Ubu avait été compris et cerné, et que les noms d’oiseaux qui volaient à côté de ceux des représentants politiques les plus éminents de ce pays qui ont amenés, quatre jours après la premiére représentation d’Ubu à Skopje, la guerre dans les faubourgs de Kumanovo n’étaient pas de simples coïncidences.
De plus pour les aider dans la construction de leurs personnages respectifs, je me servais d’images d’hommes politiques français connus, afin d’en extraire la suffisance, le ridicule ou le sérieux affiché, qu’il fallait utiliser pour Ubu et ses personnages.
" Ce qui a étonné le public était plutôt l’énergie, la vie que ces élèves et que cette pièce avait réussi à leur diffuser "
L’Un Est L’Autre : Quant a eu lieu la première du spectacle ? Quelle a été la réaction du public ?
Morvan Benoist : La spectacle a eu lieu le samedi 28 avril 2001 à Skopje dans le cadre du festival francophone de théâtre amateur de Macédoine. Cette date ne prend sa valeur que quand on la met en relation avec d’autres plus à même de lui donner un relief.
Depuis le début du mois de mars, la Macédoine était plongée dans un état de torpeur, personne ne sachant réellement ce qu’il allait advenir, tout le monde espérant la paix, mais redoutant plus réellement la guerre. Et le jeudi 3 mai, soit 5 jours après notre représentation à Skopje et la victoire de cette troupe, la guerre enflammait les abords de Kumanovo, plus précisemment les villages albanais où les rebelles albanais avaient pris position et que l’armée macédonienne pilonait afin de tenter de les en extraire.
Si je me souviens bien, le public était content et est venu nous féliciter de notre travail, mais plus que du fait du caractère mixte évident de ce travail, je crois que ce qui a étonné le public était plutôt l’énergie, la vie que ces élèves et que cette pièce avait réussi à leur diffuser, un réel échange s’étant instauré avec la salle qui, à plusieurs reprises, a manifesté sa joie par des rires, alors que les autres pièces avaient laissés le public à distance, ce qui dans un festival amateur de théâtre de langue étrangère dans un pays, est malheureusement souvent le cas du fait des difficultés linguistique du public.
L’Un Est L’Autre : Et la réaction des habitants de Kumanovo ?
Morvan Benoist : Malheureusement, la guerre ayant débuté trop tôt (elles débutent souvent trop tôt…) nous devions jouer "Ubu Roi" au "Naroden Teatar od Kumanovo "à notre retour de Bulgarie, récompense de notre victoire à Skopje, mais le jour de notre départ pour la Bulgarie, le 3 mai, la guerre se répandait sur Kumanovo, et donc de Bulgarie, la troupe a du se dissoudre, les 3 Albanais partant se réfugier en Turquie, leurs villages étant pilonés, il leur était impossible de rentrer chez eux. J’ai donc ramené les macédoniens en Macédoine, et un élève s’est réfugié en Suisse.
Nous n’avons donc pas eu la possibilité de présenter ce travail, mais la sympathie d’une personne que je tiens à signaler ici, M. Goran Ilic, forçat du théâtre sur Kumanovo et qui m’a assuré de son soutien, nous permettra le jour où tous les élèves de la troupe se reverront ensemble, de présenter enfin ce spectacle sur Kumanovo.
(Cette troupe s’appelle "VAIAJE" du nom des six comédiens qui la forment Valon, Arta, Igor, Ardian, Julija et Elena.)
" Cette pièce a été le lieu pour eux de prendre conscience qu’ils pouvaient travailler ensemble "
L’Un Est L’Autre : La montée des tensions entre Macédoniens et Albanais a-t-elle eu des répercussions sur les relations entre les acteurs ? Sur leur travail sur le spectacle ?
Morvan Benoist : Forcément, elle a eu des répercussions, mais mon rôle était de tenter de faire que les élèves veuillent continuer à travailler ensemble, alors que leurs communautés propres sans y être opposés n’y adhérait pas. Mon rôle a donc été d’insuffler une énergie afin de leur faire prendre conscience que c’etait notre projet à tous, pas seulement celui du professeur, et que c’etait eux qui se retrouveraient sur scène, nous avons donc réussi par cette espèce de fuite en avant à ne pas nous focaliser sur la crise qui s’installait. Évidemment les élèves n’étaient pas et ne sont toujours pas d’accord sur de nombreuses questions politiques, étant donné l’éducation contradictoire que l’on injecte dans la tête de ses enfants issus de la même terre. Mais cette pièce a été le lieu pour eux de prendre conscience qu’ils pouvaient travailler ensemble, que le préalable n’était pas d’être d’accord pour travailler, mais de travailler pour trouver des points d’accord, qu’il ne servait à rien de "fermer les stores" de la Macédoine, en proclamant l’état de guerre, et de régler les problèmes en comité fermé, mais de commencer par travailler afin de pouvoir régler les désaccords.
À l’heure actuelle où l’on parle de paix, de concorde et de réconciliation nationale, la guerre de l’année dernière et ses répercussions font que les communautés albanaise et macédonienne sont maintenant complètement séparées, les lycées qui même s’ils fonctionnaient de manière séparée, les élèves apprenant dans leur langue natale, les lycées donc, étaient malgré tout des zones où les élèves se voyaient. Suite à l’agression d’un professeur par un élève, les élèves sont aujourd’hui séparés spatialement, et n’ont donc plus aucun contact entre eux.
Pour les élèves en eux-mêmes, je pense qu’ils ne voyaient pas où tout cela allait les mener, mais que l’expérience les intéressait et ils l’ont tentée. Une preuve est que je viens de recevoir un message d’un élève qui me dit (je cite de mémoire) " je ne veux pas que la troupe et Ubu en restent là, et je veuxque l’aventure continue en France et en Macédoine".
" Aujourd’hui une tension reste palpable et rien n’est réellement réglé "
L’Un Est L’Autre : Votre travail théâtral a été interrompu par la guerre qui opposa les forces macédoniennes aux rebelles albanais. Que s’est-il passé exactement à Kumanovo ?
Morvan Benoist : Kumanovo est, comme nous l’avons déjà vu, une zone tampon entre trois aires de peuplement, serbe, albanais et macédonien. Suite à l’éclatement de la Yougoslavie, le facteur serbe est moins présent sur Kumanovo, mais il reste présent.
Kumanovo pourrait-être schématiquement décrit ainsi, la zone à l’ouest de la ville est une zone à majorité de peuplement albanais, alors que celle à l’est est macédonienne.
Le 3 mai, l’UCK (les rebelles albanais) ont investis la majorité des villages à peuplement albanais et en ont interdis l’accès aux forces de police et d’armée macédoniennes. En réponse, l’armée macédonienne a commencé à bombarder ces villages. Dans la ville de Kumanovo même, la paix a été préservé, seul un restaurant albanais a été plastiqué, mais n’a entraîné que des dégats matériels. Le couvre-feu a été instauré, tantôt à neuf heures du soir, tantôt à dix heures puis onze heures. Mais une tension très forte était palpable, les tirs de mortiers, les tirs d’hélicoptères, les manœuvres des chars, les tirs de kalachnikovs, tout cela s’entendait parfaitement durant la journée et mieux encore durant la nuit. Cette athmosphère a perduré du 3 mai à la mi-août, date à laquelle l’accord d’Ohrid (accord entre les USA, l’Europe et les différents partis politiques de Macédoine) ont permis de sortir d’une logique de confrontation pour aller vers une logique de règlement du conflit par une voie politique. Aujourd’hui une tension reste palpable et rien n’est réellement réglé, l’accès aux villages albanais est toujours coordonné à la création de patrouilles de police mixte, qui ne voit le jour que très lentement ; la loi d’amnistie a été votée jeudi 7 mars 2002, il y a trois jours, soit plus de dix mois après le début des conflits à Kumanovo et plus d’un an après le début du conflit en Macédoine.
La région de Kumanovo est la région où il y a eu le plus de combats et de destructions, un village comme Matejce est décimé, un village comme Slupcane est criblé de balles et de tirs de mortier et un village comme Opaje comprend un nombre de maisons brulées de l’intérieur assez conséquent. Dans certains villages, Slupcane, Vaksince ou Lojane, l’électricité est réapparue bien après la fin de cet hiver qui a été aux dires des habitants de la Macédoine un des plus froids depuis de nombreuses années. De nombreuses personnes ont donc passées cet hiver dans des conditions de vie très dures, cela ne les a pas aidés à panser leurs plaies.
La cohabitation sur Kumanovo a toujours été compliqué et conflictuelle, mais la guerre du printemps-été 2001, a agrandie encore, s’il en était besoin, le fossé qui existe entre ces deux communautés.
L’Un Est L’Autre : Comment les retrouvailles entre les acteurs se sont-elles passées ?
Morvan Benoist : Depuis le 5 mai et l’éclatement de la troupe, VAIAJE n’a pas encore pu se réunir en entier. Un élève poursuivant des études supérieures en France, un autre en Suisse, il ne reste que quatre membres en Macédoine. Mais les élèves qui ont pu se rencontrer tiennent à la poursuite de cette expérience et tous attendent avec impatience notre prochaine venue en France.
Certains conservent des relations, alors que le climat actuel où rien n’est encore véritablement réglé appelle plutôt au repli sur soi-même et sur sa communauté.
L’Un Est L’Autre : Votre spectacle a reçu des récompenses en Macédoine, puisque vous avez gagné un concours de théâtre à Skopje. Quels sont les futurs projets de "Vaiaje" ?
Morvan Benoist : Vaiaje compte donc venir en France à deux reprises ce printemps-ci afin de présenter son travail dans deux festivals de théâtre amateur, à Rennes du 1 au 7 avril, puis à Brest du 1 au 7 mai. Ensuite l’autre projet est de monter UBU à Kumanovo, avec l’aide du "Naroden teatar od Kumanovo" et de Goran Ilic. Ensuite il nous faudra faire évoluer ce projet vers quelque chose de différent, les élèves étant maintenant à la faculté, et souvent séparés, je ne suis moi-même pas sûr de pouvoir rester encore longtemps en Macédoine, ces deux voyages seront donc le moment pour les élèves de décider ce qu’ils veulent faire de ce beau, mais fragile, jouet qu’ils ont crées.
" La police nous laissa repartir un peu ahurie, un élève macédonien venait de sauver la mise à son collègue de théâtre albanais. "
L’Un Est L’Autre : L’aventure de "Vaiaje" a-t-elle changé quelque chose pour les acteurs, dans leur rapport avec les membres des autres communautés ethniques (et pas seulement avec les acteurs de la troupe), dans leurs sentiments vis-à-vis de la Macédoine, ou tout simplement dans leur vie quotidienne ?
Morvan Benoist : Effectivement l’aventure de Vaiaje a changé, pour les acteurs, leurs conceptions de l’autre, entre eux comme pour l’image qu’ils perçoivent de l’autre communauté. Ceci est plus ou moins palpable en fonction des élèves et de leur sensibilité.
Je vais juste vous raconter un événement qui reflète bien ce qui a pu changer dans la tête des acteurs.
Le 3 mai 2001, nous devions partir de Kumanovo pour la Bulgarie afin de présenter notre travail. J’arrive à Kumanovo, pour régler quelques problèmes administratifs et là, la ville m’apparaît en état de siège, l’armée est partout, une tension angoissante commence à se sentir dans le regard de la population, tout le monde en est sûr, la guerre va débuter.
Les élèves albanais de la troupe sont des villages, deux d’entre eux arrivent à quitter leur village, mais un dernier, tenant le rôle du père Ubu, ne peut arriver à Kumanovo.
Les forces militaires sont en position, il ne peut plus quitter son village. Par chance, les autorités macédoniennes n’avaient pas encore coupés les lignes téléphoniques, je peux donc joindre cet élève. Il me propose de passer à travers champs, afin de rejoindre une vieille gare où je devrais me trouver avec une voiture afin de le ramener à Kumanovo. C’est cela ou le spectacle tombe à l’eau.
Evitant d’utiliser ma voiture personelle, des plaques étrangères entraînant à ce moment de tension extrême une paranoïa policière, je prends un taxi et un élève macédonien décide de m’accompagner afin de faciliter les contacts éventuels que nous aurions avec la police. Grand bien lui en prit, arrivant à la vieille gare à l’heure convenue, nous dûmes attendre l’élève albanais une bonne vingtaine de minutes, car il dut slalommer un peu plus que prévu afin de ne pas être vu.
Mais la police macédonienne ne comprenant pas ce que nous faisions ici commença à nous interroger, mon macédonien me permet de faire rire les filles, mais pas vraiment de dérider la police trois minutes avant la guerre ; l’élève macédonien réussit donc à expliquer ce que nous faisions là. A ce même moment, l’élève albanais fit son apparition, la scène était complètement absurde, mais est en fait une bonne parabole de ce que pourrait être ce pays. La police après la fouille réglementaire nous laissa repartir un peu ahurie, un élève macédonien venait de sauver la mise à son collègue de théâtre albanais.
Plus tard, chacun de ses deux élèves m’a reparlé de cette aventure.
L’élève macédonien m’a avoué que sa famille ne voulait pas qu’il vienne avec moi chercher l’élève, pas par méchanceté, mais plus par peur de ce que cela pourrait entraîner pour lui si la guerre éclatait plus encore.
L’élève albanais de son côté m’a avoué qu’il n’oublierait jamais ce qu’il avait fait pour lui, le risque qu’il avait pris pour venir l’aider, alors que lui m’avouait qu’il ne savait pas si il aurait fait pareille dans le cas contraire. Question que l’on peut tous se poser, non ?
Enfin bref, la troupe au complet nous sommes partis en direction de la Bulgarie.
Au sortir de Kumanovo, un très beau point de vue permet d’embrasser toute la plaine qui donne sur les villages albanais. Ce jour-là, nous ne vîmes que l’embrasement sous les tirs de mortiers et d’hélicoptères des forces en présence, alors que trois élèves albanais et trois élèves macédoniens allaient représenter ensemble la Macédoine, au festival de Burgas.
Notre arrivée à Burgas se fit très tôt, vendredi matin. Après une courte nuit, nous nous devions d’être dès le vendredi présent au festival où nous avions été invités. Ce vendredi reste pour moi, le jour le plus difficile ainsi que le plus beau que j’ai eu l’honneur de passer avec ces élèves.
Ce jour-là, les élèves ont dépensé le maigre argent qu’ils avaient afin de se tenir au courant de ce qui se passait chez eux. Les nouvelles les plus contradictoire nous arrivaient, de " tout va bien ", à " les villages sont rasées ". Après une journée où nous avons tenté de nous divertir coûte que coûte, alors que le cœur n’y était qu’à peine, il nous a bien fallu nous poser la question à savoir était-il encore intéressant de continuer à faire comme si rien ne se passait, et surtout les élèves étaient-ils en condition de jouer cette pièce alors que la guerre battait son plein.
Nous nous sommes donc réunis, tous ensemble, et les élèves ont décidé de ne pas jouer et d’aller se réfugier, pour les Albanais dès le lendemain en Turquie.
Une fois cette décision prise, il nous restait une soirée à passer ensemble, qu’allions-nous en faire ?
" la véritable représentation avait eu lieu, et elle avait eu lieu pour ceux pour qui elle avait réellement une importance "
Je pense que pour les élèves, comme pour moi, cette soirée que nous avons réussi à garder sur bande vidéo restera un des plus beaux souvenirs et une des plus belles réussites de VAIAJE.
Alors que la discussion entre les élèves étaient depuis le matin assez complexe, nous nous sommes décidé à faire les cafés afin de nous divertir. Il y avait une ambiance de complicité et d’émotion entre les élèves qu’il m’a été donné de voir que très très peu souvent. L’alcool aidant, nous sommes rentrés nous coucher et là s’est passé une folie collective que personne ne s’explique encore aujourd’hui. Tout le monde avait investi sa chambre, mais personne ne pensait à dormir. Le couloir du dortoir est alors devenu une scène de théâtre improvisée, où tous les élèves se sont nerveusement lâchés, ainsi que moi, et ont donnés 20 minutes d’un spectacle d’improvisation totale. Chaque élève a inventé un rôle qui collait à sa personnalité et une folie verbale, en français, s’est emparé de nous tous. Bref nous nous jouions pas le lendemain, mais la véritable représentation avait eu lieu, et elle avait eu lieu pour ceux pour laquelle elle avait réellement une importance, un sens, ceux qui savaient ce que cela représentait pour eux.
Le lendemain, le départ des élèves albanais se fit dans les pleurs de tous, sauf des garçons, parce que quand même…
Et à ce jour, nous n’avons pas pu nous revoir tous ensemble et visionner cette cassette-vidéo.
Je ne sais après cela vous dire, si quelquechose a changé, mais je sais que plus jamais je n’ai entendu mes élèves rire aux blagues racistes que les communautés s’échangent, et tous me parlent de ces moments avec une émotion qui me fait comprendre qu’ils n’ont, comme moi, toujours pas bien compris ce qui s’est passé.
L’Un Est L’Autre : Comment imaginez-vous l’avenir de la Macédoine ? (Question pour les acteurs)
Morvan Benoist : Je n’ai à aucun moment de mon travail avec ces élèves entamé de discussions politiques et tenté de les questionner sur une question, certes importante, mais en même temps aussi complexe et aussi difficile que celle-ci. Je pense qu’à 17 ans, il est très difficile de se confronter à la réalité que le pays qui vous a vu naître va peut-être disparaître un jour où l’autre, ou sombrer dans une guerre civile.
Je ne leur ai donc pas posé votre question.
Mais je peux tenter de vous expliquer ce qu’il m’a semblé comprendre de ce qu’ils laissaient transfuser de leurs sentiments.
Tous pensent qu’il y aura toujours des problèmes en Macédoine, que la politique est trop présente ainsi que la mafia, ce qui entraîne un développement économique toujours retardé. De plus tous ont aussi conscience d’une certaine confusion entre des problèmes de vie en général difficile pour tout le monde, avec le rejet de cette responsabilité sur le voisin, processus largement alimenté par les politiques, les médias et l’environnement social en général, même s’il est évident que l’on est aujourd’hui plus égal en Macédoine suivant son appartenance où non à la communauté majoritaire.
Enfin, je pense qu’ils essayent de ne pas penser à l’avenir, et tentent au jour le jour de se construire un futur.
Il me semble de plus en plus difficile, voire même déplacé de ma part, de leur poser cette question pour m’entendre répondre " je ne sais pas ", tout en voyant ces jeunes s’investir complètement dès qu’on leur propose quelque chose de constructif.
Je botterais donc en touche votre question en répondant que la plus belle preuve du futur de la Macédoine se trouve dans l’investissement de ces jeunes dans des actions qui ne sont malheureusement que trop rares, voire inexistantes aujourd’hui en Macédoine.
Propos recueillis par Didier SCHEIN
Morvan Besnoit a également créé deux associations en Macédoine, ALUCINOVO et CLASSE-BILINGUE, une à vocation culturelle et l’autre linguistique, seules associations mixtes de Kumanovo, afin de monter le maximum de projets, et que si nos lecteurs potentiels voulaient s’investir dans des projets de ce type, il a quelques projets qui lui tiennent particulièrement à cœur, et qu’il aimerait voir se réaliser :
• projet de création du premier lieu mixte d’expression culturelle à Kumanovo, baptisée "Cosmopolite Diffusion"
• projet de création d’un festival de musique dans lequel les élèves des différentes classes bilingue, deux cette année, trois l’année prochaine, soit 75 élèves, seraient investis.
• Recherche toujours plus importante de partenaires en France, lycées, associations de développement, festival de théâtre amateur…qui aimeraient s’investir avec eux et renforcer plus encore cette dynamique unique.
Contact :

![]()
![]()


