


Propos recueillis par
Olivier
Jakobowski
Mai 2002
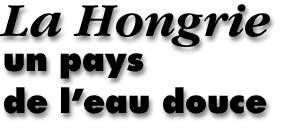
Interview de M. Bognár Gyõzò, ingénieur hydraulique hongrois
![]() n qualifie la Terre de "planète bleue", car l'eau recouvre les trois quarts de sa surface. Mais la majorité de l'eau présente sur Terre est salée et l'eau douce n'est pas bien répartie entre les différents pays ou régions du globe. Et, à mesure que la population mondiale augmente, les besoins en eau de l'humanité ne cessent de croître.
n qualifie la Terre de "planète bleue", car l'eau recouvre les trois quarts de sa surface. Mais la majorité de l'eau présente sur Terre est salée et l'eau douce n'est pas bien répartie entre les différents pays ou régions du globe. Et, à mesure que la population mondiale augmente, les besoins en eau de l'humanité ne cessent de croître.
Comme dans le reste du Monde, au Pays des Magyars, l’histoire de l'eau et celle des hommes sont intimement liées. Dans un nouveau siècle où l’eau douce de bonne qualité risque de devenir une rareté, la Hongrie a l’atout de posséder des ressources importantes en eau douce de surface puisque plus de 120 milliards de m3 d'eau traverse cet État chaque année. Cette quantité est la plus importantes du Monde par habitant. Elles est également bien pourvue en eaux souterraines avec des vertus curatives . Si on ajoute le fleuve Danube, le lac Balaton et quelques rivières, on peut considérer la Hongrie comme un pays de l’eau douce par excellence.
Monsieur Bognár Gyõzò, ingénieur hydraulique hongrois à la retraite a eu la gentillesse de répondre à mes questions et de faire un bref résumé de la situation de l’eau douce dans son pays sous différents aspects. Ce premier interview ouvre le premier volet d’un dossier L’Un [EST] l’Autre qui sera consacré au thème de l’eau douce en Hongrie. Dans ce dossier en préparation différents aspects et problématiques seront abordés : le thermalisme, les loisirs liés à l’eau, la protection de l’environnement, l’Histoire de la gestion de l’eau,le prix de l’eau en Hongrie, la journée mondiale de l’eau et les programmes de sensibilisation, les institutions hongroises liées à l’eau mais aussi la part d’irrationnel et de symbolique de cette matière. Pour ce dernier sujet, nous aborderons les poèmes, les légendes et les mythes attachés à l’eau du peuple magyar.
L’UN EST L’AUTRE : Peut on considérer la Hongrie comme un Pays de l 'eau ?
Bognár Gyõzò : Oui, on peut considérer la Hongrie comme un Pays de l'eau.
Plus de 120 milliards de m3 d'eau traverse la Hongrie chaque année. Si on calcule cette quantité énorme par habitant, c'est l'une des quantités les plus importantes du Monde. Nous sommes donc un pays transitoire au niveau de l'eau.
Nous avons aussi deux grandes rivières, la Tisza et le Dráva, le fleuve Danube et deux lacs de grande taille le Balaton et le Valencei. Nous possédons également des réserves importantes en eaux souterraines. D'ailleurs les besoins en eaux potables sont satisfaits àa quatre vingt dix pour cent par des eaux souterraines.
Il faut enfin compter les précipitations qui représentent cinquante huit milliards de m3. Elles sont diminuées par l’évaporation (évapotranspiration) de cinquante deux milliards de m3. Cette quantité d’eau alimente la végétation.
Mais cette masse d'eau a une distribution inégale dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps, il y a une alternance des saisons sèches et humides, des différences considérables de la précipitation saisonnière. Le debit de l'eau a son niveau le plus bas en août quand le débit arrivant par les rivières et le fleuve transportent le minimum.
Dans l´espace, les saisons les plus sèches sont à l´ Est du Pays.
L&L : L´ eau devient une richesse rare au niveau mondial et cette rareté risque d´ être a l´ origine de conflits futurs. On parle désormais d´ or bleu
pour imager l ´eau. La Hongrie est traversée par une masse d´ eau considérable et possède de nombreuses ressources souterraines. Quels sont les projets de la Hongrie par rapport à cet atout majeur?
Bognár Gyõzò : Presque la totalité, soit quatre vingt seize pour cent des ressources en eau des rivières de la Hongrie a pour origine des pays étrangers.
Il y a beaucoup de perte. Il faut élaborer des méthodes afin de conserver l'eau. Ce processus de meilleure gestion demande beaucoup de travaux et d'argent. Par exemple, il est important de procéder à des retenues occasionnelles au moment des crues.
L&L : Quelle est la qualité de l'eau en Hongrie ?
Bognár Gyõzò : En Hongrie, on a determiné la définition de l'eau potable en tenant compte des recommandations de l'organisation mondiale de la santé.
Selon cette définition, elle doit contenir tous les minéraux nécessaires à l'organisme et ne peut pas contenir de micro-organismes dangereux pour la santé, de matières chimiques ou irradiantes. Compte tenu de la séverité de plus en plus forte de la réglementation tandis qu'une partie des aquifères est successivement contaminée, les investissements pour maintenir l'eau potable sont de plus en plus lourds chaque année. Le plus grand danger consiste dans la contamination des aquifères proches de la surface. Les causes principales de cette contamination sont les lacunes de l'épuration des eaux usées, les décharges nocives des déchets liquides et solides ainsi que l'utilisation excessive des engrais de l'agriculture à certains endroits.
Comme partout, le développement de l'Industrie et de l'agriculture au XXe siècle ont eu des effets néfastes sur la qualité de l'eau.
Pour bien connaître l'état de la qualité des eaux, la Hongrie a developpé à la fin des années 80, un système de réseau constant de contrôle et de laboratoires conforme aux exigences de l'Europe occidentale. On publie chaque mois la qualification des eaux de surface et des eaux souterraines en employant des paramètres biologiques, chimiques et bactériologiques.
Ces observations ont constaté que la qualité de l'eau s'est sensiblement ameliorée ces vingt dernières années. Ceci s'explique pour différentes raisons. Un déclin industriel car beaucoup d´anciennes entreprises ont été fermées en raison de leur manque de compétitivité. De plus, les nouvelles entreprises ont les fonds nécessaires pour investir dans la protection de la nature environnante. Il y a aussi une utilisation de moins en moins de pesticides et de produits chimiques trop polluants dans le domaine agricole. Enfin, on a construit de nombreuses stations d'épuration.
L&L : Quelles ont eté les crues les plus destructrices au cours de l 'Histoire de la Hongrie?
Bognár Gyõzò : Le fleuve Danube et la rivière Tisza ne sont pas toujours des alliés. Ils peuvent parfois devenir des redoutables ennemis. En dehors des documents historiques remontant jusqu'à l'année 1012, des plaques conservent le souvenir de ces crues devastatrices. De nos jours encore on peut voir sur l' île Margit les ruines du couvent où son chroniqueur a fait état de l'inondation due à la débacle de l'année 1268.
Parcourant la série des crues les plus hautes – dépassant 800 cm – des deux derniers siècles, on peut constater qu'elles sont arrivées toutes, excepté celles des années 1954 et 1965, aux mois de février-mars et étaient engendrées par des embacles.
L'innondation la plus mémorable est survenue lors du mois de Mars de l'année 1838. Cette crue glaciale a devasté la capitale. Le niveau de l'eau monta a 1029 cm et la plus grande partie du territoire de la ville fut innondée. Trente huit pour cent des bâtiments tombèrent en ruine, dix huit pour cent furent endommagés et cinquante mille personnes restèrent sans logement.
Parmi les crues pluviales, d'occurrence beaucoup plus rares,
l'innondation de 1965, qui s'est produite par l'enchevêtrement de six ondes de crue successives, ressort aussi bien par sa hauteur que par sa durée. La première onde de crue culminait à Budapest le 4 Avril avec 651 cm, la sixième le 18 juin avec 845 cm. Les cinq premières ondes de crue ont eté alimentées en premier lieu par la fonte des réserves de neige des Alpes. La sixième onde a été due aux pluies estivales et les affluents y ont considérablement contribué
L&L : Quelles sont les protections et les défenses contre les crues?
Bognár Gyõzò : Tout d'abord, il est à mentionner que cinquante deux pour cent du territoire est menacée par les eaux stagnantes et presque un quart par des crues.
Concernant la protection des eaux du Danube, prévenir les dégâts d'inondation et stabiliser les rives et le chenal navigable occupait les dirigeants de Pest et de Buda déjà il y a 250 ans. Un système de défense a été construit progressivement, exhausser et renforcer les digues de défense, rehausser le niveau des avenues principales et des quais, regulariser le lit du Danube, effectuer le dragage de plusieurs millions de m3, diminuer la charge des digues par les retenues de danger, etc…
La longueur totale des digues principales de protection contre les innondations fait 4220 km, dont 67,2% sont construites aux dimensions necessaires pour résister aux crues de fréquence centenaire. Les ouvrages de protection sont construits en bonne conformite aux demandes de l agriculture.
Sinon, lors des innondations, on utilise des sacs de sable, des fagots de saule, des textiles, des machines, des palplanches,des éclairages, des canots, des bateaux, des dragues, etc… pour protéger les habitations et leurs habitants. Avec tous ces moyens, on peut desormais réguler les crues du Danube si il n'y a pas de pluies excessives.
L&L : Quelles sont les premieres traces de distribution de l'eau sur le territoire de Budapest ?
Bognár Gyõzò : Elles sont très anciennes. Les premières traces de conduites d'eau datent de l'époque romaine. Probablement, c'est la source du bain dit romain, au bord du Danube, qui a été conduite à Aquincum par des tuyaux de terre cuite d'un diamètre de 20 cm. Trois ou quatre tuyaux couraient parallèlement soutenus par des voutes sur piliers qui se suivaient a une distance de quelque trois mètres. Les restes de ceux-ci sont encore visibles de nos jours.
Déjà, au debut du XVe siecle on a monté l'eau du Danube au château royal sur la colline par une pompe refoulante actionnée par un manège se trouvant dans le bassin d'eau construit au bord du Danube. En 1416, le roi Sigismond, plus tard, Empereur germanique, a fait verser mille pièces d'or rhénanes par la ville de Nuremberg au maître Hartmann de Nuremberg qui a "fait monter a Buda l'eau de la montagne".
Enfin, le roi Mathias Corvin a fait construire, au milieu du XVe siècle une adduction d'eau basée sur la loi des vases communiquants. On a amené l' eau de trois sources des montagnes de Buda, par une conduite longue de 4 km, dans des tuyaux en bois goudronné et en plomb, d'une hauteur de 350 m, à travers une vallée située à l'altitude de 120 m, à la colline du château à 170 m d'altitude, où elle a alimenté, entre autres, une fontaine richement décorée qui se trouvait devant l'actuelle église Mathias.
L&L : En quoi, dès les origines de la ville de Budapest, le développement économique et social a toujours été étroitement lié au fleuve Danube ?
Bognár Gyõzò : Le territoire appelé aujourd'hui Budapest est devenu spontanément un centre humain grâce a sa position géographique privilégiée. Cette contrée est située entre plaine formée au quaternaire et région montagneuse de Buda et il a aussi la présence du Danube.
Ce lieu est surtout devenu une zone importante d'échanges economiques suite à la conquête hongroise. Depuis lors, il joue un role culturel et économique particulier. La présence du Danube et ses navettes puis ses ponts a eu une influence fondamentale. À budapest, il y a dix ponts qui lient les deux rives du Danube. Hors de là, en Hongrie, il y a seulement trois ponts, un au nord et deux au sud qui passent par le Danube. C'est l'une des causes principales de la centralisation.
Un autre pôle d'attractivité de Budapest est la la chance de posséder cent sept sources naturelles, de grands bains thermaux et piscines propices au développement touristique et au bien-être de sa population. Ce sont en premier lieu les maladies des organes cinétiques, le rhumatisme et les inflammations chroniques qui y trouvent leur remède.
Présentation du parcours professionnel de M. Bognar Gyozo
1953 : Obtention de son diplome d'ingenieur génie civil dans le domaine des ponts et des constructions.
1956 : Premier poste à Baia, ville de près de 40000 habitants à côté du Danube près de la frontière yougoslave. Dix ans plus tard, il est devenu le directeur de cet organisme après avoir debuté comme stagiaire.
1964 : Obtention de son second diplome d'ingénieur économe.
1969 : Arrivée a Budapest en tant que chargé des constructions hydrauliques au sein du centre de l'office national des eaux. Il a été aussi au cours de cette période le directeur général d'un trust hydraulique.
Août 1976 : Directeur de l'institut du développement technique de Vituki, centre de recherche scientifique dans le domaine hydraulique.
Septembre 1991 : Retraité tout en conservant de nombreuses activités comme par exemple, bénevole dans une association hydraulique et intervenant au centre de Vituki sur differentes questions par rapport à la gestion de cette société anonyme.

![]()
![]()


