


Par
Guillaume
Vincenot
Novembre 2002

I) Introduction
La Hongrie est un petit pays d’Europe centrale qui a beaucoup souffert au cours de son histoire. Jugez plutôt : au milieu du 16e siècle les Turcs prennent possession de Budapest et l’occupent jusqu’en 1686. C’est alors la maison des Habsbourg qui va contrôler le pays jusqu’en 1918. A la suite d’alliances malheureuses, la Hongrie en 1920 est punie par les Alliés par l’intermédiaire du traité de Versailles qui lui fait perdre 71% de son territoire et 61% de sa population. Elle est alors indépendante jusqu’à la deuxième guerre mondiale, où elle passe dans la sphère d’influence allemande pour ensuite passer sous contrôle russe jusqu’en 1989. Le 23 octobre 1989, la République de Hongrie est enfin proclamée et depuis elle espère rentrer dans l’Europe. Ce souhait pourrait devenir réalité en 2004.
Il existe un domaine particulier où les Hongrois sont particulièrement performants et où ils sont reconnus en Europe, c’est celui de l’industrie de l’aluminium. Ils commencent à exploiter la bauxite au début du 20e siècle. Ce n’est qu’en 1934 qu’elle devient la base d’une industrie nationale de l’aluminium. En effet, à cette date est crée la première usine d’alumine1 et parallèlement celle d’aluminium2. Sous contrôle allemand avant et pendant la deuxième guerre mondiale, puis surtout sous contrôle russe, cette industrie n’aura de cesse de se développer jusqu’en 1975 3.
II) La filière de l’aluminium en Hongrie
Plusieurs raisons permettent d’expliquer le développement de la filière de l’aluminium en Hongrie. C’est bien sûr tout d’abord les très grandes réserves de bauxite dont dispose le pays. Il a donc tout intérêt à développer son activité d’extraction de ce minerai. Dans un premier temps, il nourrira d’importantes exportations et dans un second temps il l’utilisera comme base de son industrie naissante de l’aluminium. Une fois la première étape franchie, les Hongrois vont en effet développer leur production d’alumine puis celle d’aluminium même si cette dernière va rapidement être entravée par le manque d’énergie bon marché disponible en Hongrie4.
La quasi-totalité de la bauxite extraite va être exportée vers l’Allemagne avant et pendant la guerre et c’est pourquoi les quantités d’alumine et donc d’aluminium produites par les pays seront très faibles pendant cette période même si elles sont en augmentation notamment pendant une partie de la seconde guerre mondiale. La fin de la guerre met un terme à cette dynamique.
Cependant deux raisons majeures vont entraîner par la suite un développement intense de la filière. Le premier tient au fait qu’au sortir de la guerre, la Hongrie est un pays détruit qui doit se reconstruire. Or elle est pauvre en cuivre, fer, zinc et plomb et elle ne souhaite pas recourir à leur importation jugée trop onéreuse. L’aluminium fournira alors un précieux métal de remplacement chaque fois que cela s’avérera possible. Disposant de grandes réserves de bauxite, la Hongrie souhaite alors tout naturellement développer son industrie de l’aluminium. En fait, et c’est la deuxième source d’explication, ce développement tient aussi à des raisons politiques. En effet, après guerre, la Hongrie appartient au bloc communiste et toute sa politique économique va dorénavant en dépendre. C’est l’un des pays du bloc qui dispose des plus grandes réserves de minerai et cela intéresse l’URSS. De plus la Hongrie ne peut développer seule sa filière puisqu’elle ne dispose pas ou peu d’énergie bon marché. Or certains pays dont l’URSS en dispose. On comprend alors que le destin de Hongrie, au moins dans le domaine qui nous intéresse, est lié aux pays communistes et bien entendu, en premier lieu, à l’URSS.
III) Une production sous tutelle
La Hongrie n’a jamais accepté le traité de Trianon et dans les années 30 elle souhaite réparer cette injustice. De plus elle appartient géographiquement et historiquement à la sphère d’influence de l’Allemagne. C’est ainsi qu’elle va se rapprocher de ce pays et soutenir ses préparatifs guerriers à l’orée de plus grand conflit mondial qui a jamais eu lieu et c’est ce qui explique qu’une grande partie de ses exportations de bauxite avant guerre sont à destination de l’Allemagne. Ce pays prépare en effet son effort de guerre et il a besoin de grandes quantités d’aluminium en particulier afin de développer son industrie aéronautique militaire. Il est donc intéressé par les grandes quantités de bauxite disponible en Hongrie. Cependant, au cours de la guerre, plutôt que d’acheminer le minerai sur les lieux de transformation germaniques, les Allemands préfèrent développer directement la filière en territoire hongrois. C’est ainsi qu’ils prennent le contrôle des opérations dans les usines, surveillent la production, l’organisent et même créent des usines. La fin de la guerre met un terme à ce phénomène et c’est désormais au tour des Russes de contrôler la production hongroise de bauxite, d’alumine et d’aluminium.
Tout est alors mis en œuvre pour que la Hongrie soit dotée d’une grande industrie de l’aluminium. La production est structurée et organisée par l’intermédiaire de différents plans triennaux et quinquennaux dictés depuis Moscou. L’URSS fournit même lorsqu’il le faut de substantiels crédits. Une fois la capacité maximale de production de métal aluminium atteinte ou proche de l’être, eu égard aux problèmes énergétiques déjà évoqués, un vaste plan de troc alumine-aluminium se met en place dans les années 60. C’est non seulement l’URSS5 qui recevra d’importantes quantités d’alumine de la part de la Hongrie mais aussi la Pologne6. Ces pays livreront alors à leur tour de grosses quantités d’aluminium métal.
IV) Les participations étrangères dans l’industrie de l’aluminium hongrois
C’est un des aspects qui contribuent à illustrer le fait que la filière de l’aluminium hongrois est sous tutelle étrangère.
Avant guerre, on peut noter qu’il existe des participations suisses, américaines et bien entendu allemandes dans certains lieux de production et d’extraction. Pendant la guerre les usines créées le sont sous contrôle direct des Allemands et de manière générale, ces derniers orientent la production de la totalité de la filière.
L’après guerre voit s’opérer le transfert des anciennes participations allemandes aux mains des russes au titre des réparations de guerre. Ainsi, dans les sociétés où existaient conjointement des intérêts allemands et des intérêts hongrois, on assiste à la constitution d’entreprises mixtes hungaro russes. Dès le 27 août 1945 est signé à Moscou un accord réglant les modalités de constitution et d’exploitation de sociétés gouvernementales hungaro russes, appelées à régner sur le marché hongrois de la bauxite et de l’aluminium. Les 3 constitutions possibles de sociétés sont les suivantes :
– les entreprises considérées comme biens ennemis passent entièrement aux mains des Russes
– les entreprises entièrement hongroises le demeurent
– les entreprises hongroises avec participations étrangères le restent.
On assiste alors le 18 février 1948 à l’étatisation de l’économie puisque les biens purement hongrois sont nationalisés à cette date. En avril 1949 les participations étrangères sont rachetées et intégrées dans le secteur nationalisé.
On peut dire qu’à partir de cette date et plus qu’avant encore la Hongrie possède un rôle de façade. En effet, la politique économique alors mise en œuvre est caractéristique des pays communistes, sous influence russe et on peut supposer qu’elle est dictée depuis Moscou.
On peut cependant noter que le 7 novembre 1954 un communiqué officiel fait savoir que les parts soviétiques dans les compagnies mixtes hungaro soviétique exploitant la bauxite et l’aluminium ont été transférées à la Hongrie. Cet accord prévoit par ailleurs que la Russie sera remboursée de la valeur des part ainsi cédées. En réalité, il s’agit d’un désengagement apparent car les soviétiques continuent toujours à organiser et à contrôler la production au moyen de plans quinquennaux par exemple.
De manière générale, la Hongrie commencera à s’émanciper de la tutelle soviétique à partir de 1968, grâce à Janos KADAR et à sa politique d’ouverture économique à l’étranger qui continue d’ailleurs à l’heure actuelle de porter ses fruits bénéfiques à l’économie hongroise.
V) Les sites de production 7
a)La bauxite
Les mines de bauxite se trouvent principalement au nord et au nord est du lac Balaton. Pendant toute la période considérée, les Hongrois vont ouvrir de nouvelles mines, moderniser et mécaniser davantage ce qui aura pour effet notamment d’augmenter les quantités extraites.
b) L’alumine
En 1934 est créée la première usine d’alumine, située à Moson-Magyarovar.En 1943, rentre en activité l’usine d’Ajka puis celle d’Almafuzito en 1950. De grands travaux d’agrandissement et de modernisation sont réalisés pour plusieurs d’entre elles.
c) L’aluminium
En 1935 un atelier est ouvert à Csepel puis en 1940 une usine commence à produire à Felsogalla.En 1943 c’est une usine située à Ajka qui commence à produire. L’usine d’Inota8 crée après guerre commence à produire en 1952.
VI) L’aspect technique
Jusqu’en 1937, l’exploitation de bauxite n’a lieu que dans des mines à ciel ouvert. A partir de cette date, elle a lieu aussi dans des mines souterraines. Des travaux de mécanisation et d’automatisation ont régulièrement lieu dans ces mines, ce qui permet d’accroître la production. De manière générale la qualité de la bauxite extraite est très bonne.
Après avoir tenté d’utiliser le procédé à sec Deville Péchiney afin de transformer la bauxite en alumine, les hongrois adoptent finalement le procédé Bayer. Pas d’innovations notables donc sauf, peut-être, dans le traitement des boues rouges obtenues après le traitement de la bauxite puisque les Hongrois ont tenté de récupérer le fer qu’elles contenaient par différentes techniques. Dans le cas de l’alumine aussi, on note que des travaux d’agrandissement et de modernisation des installations existantes sont régulièrement entrepris. Ce sera le cas aussi pour les usines d’aluminium. Ces dernières sont classiquement pourvues de cuves Soderberg de différents ampérages.
VII) La production 9
Avant et pendant la guerre on peut noter une grosse production de bauxite tandis que les chiffres de production d’alumine et d’aluminium sont plus modestes. La guerre va bien entendu mettre un frein pendant un ou deux ans au développement de la filière de l’aluminium dans son ensemble.
Durant la période de l’après-guerre, la production hongroise en matière de bauxite, d’alumine et d’aluminium va être dirigée par l’intermédiaire de différents plans triennaux et quinquennaux10 mis en place par les Soviétiques ainsi que par différents accords de troc. C’est une période faste pour les Hongrois car ces différentes mesures vont avoir comme conséquence d’augmenter de manière significative les chiffres de production.
a)La bauxite 11
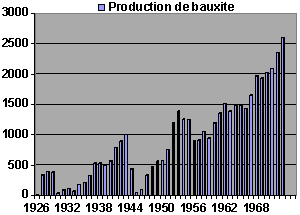
On peut distinguer 3 grandes parties dans le graphique ci-dessus :
La première s’étend de 1926 à 1930. On constate alors qu’au début de la période considérée les quantités extraites ne seront à nouveau atteintes qu’en 1937, puis elles chutent brutalement en 1930. Cependant faute d’archives nous ne pouvons fournir une explication satisfaisante sur l’origine de cette chute.
La deuxième commence en 1930 et s’achève en 1945. La production augmente alors de manière constante jusqu’en 1943 puis chute jusqu’en 1945. Les Allemands prennent en main la production ce qui a pour effet d’augmenter les chiffres de production. La baisse de 1944/1945 est naturellement à imputer à la fin de la guerre.
La troisième débute en 1945 et se termine en 1975. C’est la période russe. La production augmente régulièrement et fortement. On note un fléchissement de la production aux alentours de 1956, date de la révolution hongroise menée contre l’occupant russe. On peut alors peut être estimer que la population constituée de mineurs était largement revendicatrice et ce pourrait être un élément explicatif de cette baisse.
b) L’alumine
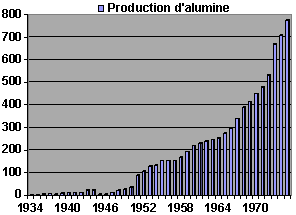
A la lueur de ce graphique on peut faire apparaître deux grandes périodes :
La première est celle des balbutiements. Elle s’étend de 1934 à 1945. Presque inexistante au début la production commence à augmenter pendant la guerre à la suite du contrôle allemand des usines. La fin de la guerre correspond à une production quasi nulle en matière d’alumine et s’ouvre alors la deuxième période.
C’est celle qui commence en 1945 et qui fini en 1975. Sous contrôle russe la production s’épanouit et il est intéressant de constater que la croissance est de plus en plus importante12. Ainsi donc, non seulement on produit plus, mais on veut produire de plus en plus. Au milieu des années 60 ce fait est particulièrement significatif. On peut sûrement imputer cette dynamique aux différents accords de troc passés entre la Hongrie d’une part et la Pologne et l’URSS d’autre part. En effet ces accords obligent la Hongrie à produire d’avantage d’alumine afin de pouvoir en exporter une grande partie.
c) L’aluminium
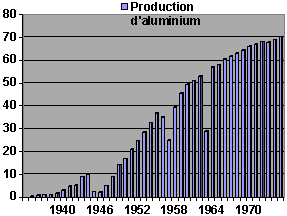
Deux grandes phases se dessinent :
La première correspond à la même influence allemande déjà décrite précédemment et couvre la même plage temporelle : de 1935 à 1945.
La deuxième, qui va de 1945 à 1975 correspond elle aussi à l’influence russe déjà décrite. Cependant les observations ne sont pas les mêmes. En effet on constate ici que les chiffres de production indiquent que la croissance est de moins en moins importante13. On produit donc de plus en plus mais on ne cherche pas à accroître de manière spectaculaire la production. L’accroissement de production est même de plus en plus faible au cours des années. Les accords de troc passés expliquent cette tendance (puisque les Hongrois reçoivent de l’aluminium métal la nécessité d’en produire plus par eux-mêmes est moins grande) mais aussi les problèmes énergétiques déjà évoqués. En effet la Hongrie dispose d’installations lui permettant de produire de l’aluminium grâce à l’utilisation de différentes sources d’énergie primaire bon marché. Produire plus signifierait aller chercher d’autres types d’énergie peut-être plus onéreuse et donc moins rentable. En résumé, la Hongrie dispose d’une capacité suffisante de production d’aluminium, et souhaite plutôt intensifier ses efforts dans le domaine de l’extraction de bauxite et dans celui de la production d’alumine. Notons que la baisse de production observée autour de l’année 1956 semble être imputable à la révolution déjà évoquée, en particulier à cause de destructions effectuées sur le matériel. Aucune explication malheureusement en ce qui concerne la deuxième chute, faute d’archives portant sur le sujet.
VIII) La production d’aluminium hongrois dans le monde
Jusqu’en 1961, la Hongrie va devenir un acteur de plus en plus important dans la production mondiale d’aluminium. En effet, la moyenne annuelle de production d’aluminium en Hongrie entre les années 1935 et 1939 est de 1150t, ce qui représente en moyenne 0,23% de la production mondiale. De 1939 à 1945 elle est 5200 t, ce qui représente en moyenne 0,43% de la production mondiale. Entre 1945 et 1948, 4660t en moyenne soit 0,51% du total de la production mondiale. Entre 1948 et 1954 la Hongrie produit en moyenne 21060 t d’aluminium ce qui représente une moyenne de 1,08% du total de la production mondiale. De 1,12% du total de la production mondiale en 1961 elle passe à 0,741% en 1968, chute lente et régulière qui se poursuit jusqu’en 1975 au moins. Ces chiffres sont explicables par ce qui a été dit plus haut.
Guillaume Vincenot
guillaumevincenot@hotmail.com
1 C’est celle de Monson-Magyarovar
2 C’est plutôt un atelier , situé à Csepel
3 Elle continue à se développer par la suite mais c’est à cette date que nous arrêtons notre article.
4 Rappelons en effet que le l’opération d’électrolyse nécessaire pour extraire l’aluminium métal de l’alumine est grande consommatrice d’énergie.
5 En 1962
6 En 1960
7 Voir la carte de la Hongrie
8 Proche de Székésfehervar
9 Les chiffres donnés dans les tableaux sont en milliers de tonnes
10 Le 1er août 1945 est mis en place un plan triennal (qui prévoit en particulier le développement de la production d’aluminium).Trois plans quinquennaux sont successivement mis en place en 1956, 1961, 1966.
11 Les quantités données sont en milliers de tonnes
12 Il en va de même pour la bauxite
13 Essentiellement à partir des années 60

![]()
![]()


