


André
Székely
Février 1995
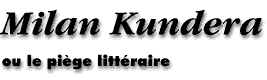
![]() ’écrivain tchécoslovaque Milan Kundera est très célèbre en France. La sortie d’un de ses romans ou de l’un de ses essais littéraires éveille l’attention d’une grande partie du public. Ce succès, l’écrivain ne l’a pas tellement recherché, mais comme il le souligne : « On doit presque toujours son succès au fait d’être mal compris ». Kundera est un homme qui vit en secret, dans l’ombre parce qu’il ne veut pas devenir prisonnier des médias et de la « dictature de l’actualité » en particulier.
’écrivain tchécoslovaque Milan Kundera est très célèbre en France. La sortie d’un de ses romans ou de l’un de ses essais littéraires éveille l’attention d’une grande partie du public. Ce succès, l’écrivain ne l’a pas tellement recherché, mais comme il le souligne : « On doit presque toujours son succès au fait d’être mal compris ». Kundera est un homme qui vit en secret, dans l’ombre parce qu’il ne veut pas devenir prisonnier des médias et de la « dictature de l’actualité » en particulier.
Son œuvre est ambiguë et souvent mal interprétée. Il y a deux causes principales à cela. Tout d’abord, le fait que Kundera se soit réfugié en France en 1975 a permis à la critique occidentale de lui coller, avec empressement, l’étiquette utile de dissident alors que Kundera est avant tout un écrivain. Ensuite, le public a apprécié Kundera parce qu’il écrivait de belles histoires faciles à comprendre. Ces appréciations et jugements hâtifs perdent l’essentiel ; l’œuvre telle qu’elle nous appraît et qu’il faut saisir.
Kundera n’est pas un Soljénitsyne qui dénonce les cruauté du communisme, les souffrances humaines face à la tyrannie. Kundera se propose de décrire les balbutiements des hommes prisonniers du fossé qui sépare leurs actes de leur expression par le langage. Son premier roman, « La Plaisanterie », paru en 1968 n’est pas un réquisitoire contre le stalinisme mais une histoire d’amour entre deux personnages, Ludvik et Lucie.
Pourtant, les français ont, pour la plupart effectué une lecture politique du livre, et cela pour plusieurs raisons. La date de parution : 1968, alors que la Tchécoslovaquie décide de se libérer du joug soviétique lors du printemps de Prague. Il est donc aisé de voir dans ce roman un témoignage d’une époque, d’y trouver les symboles d’une révolte.
Ce qui va renforcer cet aspect politique en France, c’est qu’Aragon ait décidé de préfacer ce livre (sans l’avoir lu), afin d’en faciliter la publication. Son texte : « Je me refuse à croire qu’il va se faire là un Biafra de l’esprit. Je ne vois pourtant aucune clarté au bout de ce chemin de violence » est capital pour éviter d’oublier les événements de Prague, mais il n’évoque pas le roman. C’est nourri par cette réputation que circulera « La Plaisanterie » en France. Les obstacles n’épargneront pas le livre par la suite, ce qui nécessitera l’intervention de l’auteur, qui devra s’élever contre l’interprétation univoque des journalistes : « Le roman est un art profondément anti-idéologique, car l’idéologie nous présente toujours le monde du point de vue d’une seule vérité. C”est pourquoi, je le répète, le roman est un art anti-idéologique, et il est, dans notre monde tellement idéologisé, nécessaire comme le pain ».
Dans « l’Art du Roman », Kundera expliquera sa conception et son héritage personnel du roman, à savoir : Rabelais, Cervantès, Diderot, Kafka, Musil… Cette image de dissident doit s’estomper derrière le visage moins éphémère qu’est celui du romancier expérimentateur. Mais une nouvelle fois l’œuvre devra être défendue par l’auteur, car un mal profond lui colle à la peau. Celui qui ronge l’œuvre de l’intérieur : la traduction.
En 1979, Alain Finkielkraut interviewe Kundera pour le « Corriere della Sera » et lui pose cette question : « Votre style, fleuri et baroque dans “La Plaisanterie” est devenu dépouillé et limpide dans vos livres suivants. Pourquoi ce changement ? ». Quelle ne fut pas la stupéfaction de l’écrivain tchèque à l’écoute des qualificatifs employés ! Pendant des années cette œuvre était parue en France sous ce terrible affublement qui l’a dénaturée. Mais maintenant, si l’on déplace le problème fondamental de la traduction pour s’interroger sur le sens de l’œuvre, en la lisant dans les meilleures conditions, alors le véritable obstacle surgit.
Un obstacle que beaucoup de lecteurs n’ont pas franchi, pour ne voir dans les romans de KUNDERA que des histoires intéressantes et bien écrites. Derrière le masque d’une littérature inoffensive et saisissable se cache un acide qui s’écoule avec lenteur pour nous faire entrer dans « l’ère du soupçon », pour reprendre le titre de Nathalie Sarraute. Kundera démonte les mécanismes des relations humaines avec méthode, calme, lucidité, broie lentement toutes les valeurs auxquelles on réfère sans jamais oser les remettre en question, sur un ton léger, virevoltant. Mais il faut aller plus loin, accepter le défi de Kundera et pénétrer plus en avant, dépasser les limites visibles comme il nous y convie, atteindre des profondeurs inconnues en choisissant d’éclater de rire pour ne pas succomber à l’effroi donné par la réalité mise à nue.
Malgré des apparences trompeuses, la littérature de Kundera appartient à la plus grande littérature, une littérature totale. Mais pour en arriver au noyau central, il faut déjouer des pièges complexes, camouflées derrière un style qui ne déroute pas du premier abord. Lorsque le lecteur est piégé, traqué, une fois aux mains, il retourne inéluctablement vers cette source qui constitue l’œuvre de Kundera.
Tous les obstacles qui freinent la lecture de Kundera sont autant d’indices de sa valeur. La plupart des gens qui lisent « La Valse aux adieux » ou « Le Livre du rire et de l’oubli » sans pénétrer dans les strates profondes qui se succèdent, des strates noircies, extrêmement complexes de l’âme humaine.
On touche le fondamentalement humain en lisant Kundera, l’acte de lire prend la valeur d’une métempsychose, l’âme voyage très loin dans le puits de l’origine. Lire devient acte de violence pour une nouvelle naissance.
André Székely



