


Didier
Schein
Mai 1999
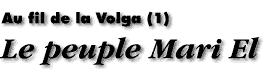
«Le dieu Iula avait une fille jeune et belle, mais de fiancé au ciel elle n’en avait pas. Là-bas il n’y avait que des anges.
Iula était assidu à la tâche, c’est pourquoi au ciel il ne gardait pas les travailleurs. Il faisait tout lui-même et envoyait sa fille faire paître le bétail.
Au ciel il n’y a pas d’herbe, c’est pourquoi le bétail devait descendre sur terre. Aussi le dieu le faisait descendre du ciel chaque jour, et avec le bétail il faisait descendre aussi sa fille. Il ouvrait le ciel, il écartait le feutre, afin que celui-ci atteigne la terre même, et dessus il faisait descendre sa fille et le troupeau directement sur terre.
Une fois étant sur terre, la jeune fille céleste rencontra un homme. Il s’appelait Mari. Il vivait sur terre et d’aucune façon ne consentait à aller chez Iula. Alors la jeune fille ne put monter au ciel et resta sur terre. Elle se maria avec Mari et d’eux survinrent des hommes. Ceux-ci furent le peuple Mari El.»
![]() ontrairement à ce que l’on peut s’imaginer, sur les rives de la Volga, le plus grand fleuve d’Europe (pour beaucoup symbole de la Russie au même titre que la Place Rouge et le Kremlin), ne vivent pas que des Russes. Le long de son cours se sont fixées, depuis des siècles, des populations différentes, dont on n’a sans doute jamais entendu parler en France, à part peut-être, les Tatares. Tout au long de cette série, nous descendrons le cours du grand fleuve, en remontant parfois celui de l’histoire, pour découvrir ces peuples oubliés, aux noms souvent étranges. Et pour cette première escale, nous allons rendre visite aux Mari, qui habitent le bassin de la Volga, entre Nijni-Novgorod et Kazan…
ontrairement à ce que l’on peut s’imaginer, sur les rives de la Volga, le plus grand fleuve d’Europe (pour beaucoup symbole de la Russie au même titre que la Place Rouge et le Kremlin), ne vivent pas que des Russes. Le long de son cours se sont fixées, depuis des siècles, des populations différentes, dont on n’a sans doute jamais entendu parler en France, à part peut-être, les Tatares. Tout au long de cette série, nous descendrons le cours du grand fleuve, en remontant parfois celui de l’histoire, pour découvrir ces peuples oubliés, aux noms souvent étranges. Et pour cette première escale, nous allons rendre visite aux Mari, qui habitent le bassin de la Volga, entre Nijni-Novgorod et Kazan…
Nous ne saurons dire si les Mari sont vraiment les descendants du dieu Iula, mais les historiens s’accordent pour faire remonter le noyau de ce peuple (mari en langue mari signifie homme) aux tribus finnoises venues des monts Oural et établies au premier millénaire de notre ère entre la Volga et la Viatka, territoire qu’ils occupent encore de nos jours. Au Xe siècle, un document Khazar mentionne pour la première fois les Mari, qu’on appelait à l’époque Tchérémisses. Un grand rôle dans la formation du peuple Mari a été joué par les liens ethno-culturels étroits entretenus avec les peuples turcs de la région, les Bulgares, les Tatars et surtout les Tchouvaches. Sous la domination de la Horde d’Or, puis du Khanat tatare de Kazan, les Mari étaient à l’époque organisés dans une société clanique et non-féodale, et gardent encore de la période le souvenir de princes et d’élites glorieuses. Certains princes étaient liés alors aux élites tatares mais en 1552, les Mari se rallièrent pour la plupart au tsar Ivan le Terrible, qu’ils aidèrent dans la conquête de Kazan.
Depuis lors, l’influence des Russes chez les paysans mari s’est intensifiée notamment dans le domaine de la vie domestique. Se sont propagées de nouvelles cultures maraîchères, horticoles et céréalières, sont apparus les séchoirs à blé en rondins, les fournaux, de même que des habitudes culinaires particulières, tandis que s’étendaient au sein du peuple mari le type d’habitations de la Russie du nord, avec l’izba de rondins (port en langue mari), à deux parties (izba-entrée) ou trois parties (izba-entrée-izba ou izba-entrée-remise) et à toit en pente double. Peu à peu, les élites mari s’intégrèrent aussi à la noblesse russe. Dès la fin du XVIe siècle, commença également un processus de christiannisation des Mari, jusqu’alors païens, qui s’intensifia au XVIIIe siècle. Les cultes anciens demeurèrent pourtant, camouflés parfois dans les fêtes chrétiennes. Au XIXe siècle, la répression tsariste contre les cultes préchrétiens s’aggrava et émergea alors parmi le peuple Mari un sentiment national, basé surtout sur la défense de la foi traditionnelle. Ainsi, dans les années 1870, fut créé la secte Kugu Sorta (La Grande Bougie) qui voulait réformer les anciennes croyances sur la base d’une idéologie nationaliste conservatrice. Cette secte eut une forte influence sur la population mari de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et joua surtout un rôle important pendant les années 20 et 30, dans la mobilisation des paysans contre la collectivisation des terres. D’autre part, une intelligentsia mari avait commencé à se former à la fin du siècle passé et en 1907, parut la première publication en langue mari ; un calendrier, puis en 1915 le premier journal. En 1917 vit le jour une organisation politique nationale mari, Mari Uchem (l’Union Mari) qui fut interdite en décembre 1918. Après la révolution d’octobre, les Mari obtinrent un statut d’autonomie et se forma en 1936 une république autonome qui prit le nom, en 1992, de République Mari El, au sein de la Fédération de Russie.
Aujourd’hui, les Mari sont au nombre de 643 000, dont 324 000 vivent dans la République Mari El, soit 43 % de la population de la république (un peu moins que les Russes). Les autres populations mari se trouvent surtout dans les républiques voisines de Tatarstan, Oudmourtie, Bachkorostan, ainsi que dans les régions de Nijni-Novgorod, Kirov, Sverdlovsk et Perm. Le pays Mari a gardé un caractère essentiellement rural (couvert à 40 % de forêt). La population mari, rurale à 60 %, s’occupe surtout de cultures céréalières et d’élevage. La capitale, lochkar-Ola (La Ville Rouge, en mari), ville de 200 000 habitants, est un centre industriel spécialisé dans le travail du bois et de ses dérivés. On y trouve aussi quelques industries légères.
Linguistiquement, les Mari se rattachent au groupe volgaïque des langues finno-ougriennes, famille de langues non indo-européennes dont font partie nottament le hongrois, le finnois et l’estonien, mais également les langues de divers petits peuples de Russie, comme les Komi, les Mordves, les Oudmourtes, les Caréliens(1)… Les Maris se divisent en trois groupes ethniques qui correspondent aussi à trois dialectes : les Kouryk-Mari, Mari de la Montagne, établis sur la rive droite escarpée de la Volga ; les Olyk-Mari, Mari de la Plaine, habitant entre la Volga et la Viatka ; et les Kojla-Mari, Mari de la Forêt, demeurant à l’est de la Viatka jusqu’au Bachkorostan. Le kojla-Mari et le olyk-Mari sont des dialectes proches qui ont formé les deux langues littéraires mari, mais qui ne comprennent que deux tiers de mots communs avec le kouryk-Mari. La langue mari demeure aujourd’hui encore très vivace. Ainsi, lors du recensement de 1989, 81 % des Mari considéraient le mari comme leur première langue et un quart de la population ignorait le russe.
Cependant c’est également dans le domaine de l’organisation sociale et familiale, et dans celui des croyances religieuses que les Mari conservent une profonde originalité. Dans la famille traditionnelle mari, la femme possède une grande liberté. Elle exécute les mêmes travaux que l’homme et prend sa place de chef de famille après son décès. La famille moderne perpétue ses traditions matriarcales liées à un culte féminin de quatorze déesses. Jusqu’au début du siècle, étaient également pratiqués le lévirat(2) et le sororat(3).
Dans l’izba traditionnelle, le long de l’entrée et à côté des murs se trouvent des bancs (olymbal) ; dans le coin de devant, une table avec la chaise en bois (piuken) du chef de famille et des rayons pour les icônes et la vaisselle. À côté de la porte d’entrée, un lit en bois ou de planches ; au dessus des fenêtres, des serviettes brodées. Chez les Kojla-Mari, l’intérieur ressemble assez à celui des Tatares, avec de larges lits de planches contre le mur de devant et des rideaux à la place des cloisons. L’été, les Mari passent vivre dans la cuisine estivale (kudo), construction de rondins au sol en terre battue, sans plafond, avec un toit à pente simple ou double, dans lequel ont été faites des fentes pour évacuer la fumée. Les dépendances comprennent aussi une remise, une cave, une étable, une grange à foin, un bain.
La nourriture traditionnelle mari a beaucoup d’analogies avec la cuisine russe (palmeni, crêpes, fromage blanc) ; la cuisine mari connaît cependant certains plats spécifiques, et assez affolants pour les Européens ; à base de viande d’écureuil, d’épervier, de grand-duc, de hérisson et même… de couleuvre et de vipère. Ils boivent habituellement de la bière (pura), ainsi qu’une boisson forte à base de miel, le puro. Les vêtements traditionnels avec notamment, chez les femmes, un tablier orné sur la poitrine de perles, de monnaies, ou d’autres objets brillants, se rencontrent encore chez les anciennes générations, ainsi que lors des noces.
La médecine traditionnelle mari se basait sur la représentation des forces de la vie cosmique, de la volonté des dieux, sur la croyance au mauvais œil, aux mauvais esprits, aux âmes des morts. Les guérisseurs et les sorciers enseignaient leur savoir à leurs élèves dans un profond secret. Dans la foi mari existe le culte des ancêtres, d’un panthéon divin (Kugu Iumo, le dieu suprême, Mer Iumo, le dieu de la société, Tünia Iumo, le dieu du monde, Kava Iumo, le dieu du ciel et du destin, Vüd Ava, la mère de l’eau, Ilych Chtochyn Ava, la mère de la vie, Chtochyn Ava, la mère de la naissance, Kuryk Kugu En, le dieu des tribus, etc). De caractère archaïque, le culte des ancêtres se basait sur l’inhumation du mort dans ses vêtements d’hiver (chapka et moufles) et le transport du corps au cimetière en traîneau, même l’été. Dans les enterrements traditionnels se reflétaient les représentations du kiamat, le monde des morts. Avec le défunt on enterrait ses ongles recueillis durant toute sa vie (car ils sont utiles pour le passage dans l’autre monde, pour vaincre les montagnes, en s’accrochant aux rochers), des branches d’églantier (pour chasser les serpents et le chien qui garde l’entrée du kiamat), et un morceau de toile (sur lequel, comme sur un pont au dessus d’un gouffre, l’esprit atteint le monde des morts). La foi mari, comme dans la plupart des religions archaïques, ne connaît pas de temple, les célébrations cultuelles et les prières ont lieu au contact direct des forces de la nature et du cosmos, dans les forêts.
Actuellement, la culture mari connaît une certaine renaissance. Ainsi, l’organisation « Mari Uchem » a repris son activité en 1990. En octobre 1992, aux troisièmes assises du peuple mari, à Iochkar-Ola, a été élu le Mari Mer Kanach, le conseil de tous les Mari. Ces deux organisations tentent de développer la conscience nationale et l’activité politique mari. Mais c’est surtout la foi et les croyances traditionnelles qui renaissent avec ampleur ces dernières années. La secte Kugu Sorta est réapparue, tandis qu’aux rangs de la société « Ochmari-Tchimari » dont le but est d’unifier la religion nationale mari, ont été organisées des prières dans les bois, comme aux anciens temps, et à Iochkar-Ola lui appartient maintenant une « chênaie » destinée à la célébration du culte.
On peut bien sûr se poser des questions sur l’avenir de cette résurgence nationale, culturelle et religieuse, d’un peuple si petit, oublié de tous au fin fond de la Russie. Car à l’heure des défis économiques et des mutations sociales, un tel mouvement pourrait bien avoir des allures de repli sur soi passéiste. Ou plutôt faudrait-il voir dans la renaissance mari d’aujourd’hui une façon originale de trouver des solutions au plus près de ses racines, de construire l’avenir en s’appuyant sur les bases d’une culture plongée dans un inconscient national ? Car n’oublions pas qu’en Russie vivent 25 millions de citoyens russes, mais non russes de nationalité, soit un cinquième de la population, dont la diversité doit composer aussi l’identité d’un pays qui se cherche.
Didier SCHEIN
Notes :
1. Voir L’Un [EST] l’Autre n° 1.
2. Lévirat : loi hébraïque qui obligeait un homme à épouser la veuve de son frère mort sans descendant mâle.
3. Sororat : loi qui oblige un homme veuf à épouser la sœur de sa femme défunte.
![]()
![]()



