


Laurent
Girard
Mai 2000
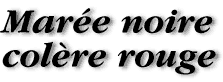
![]() e mazout de l’Erika a depuis longtemps quitté nos écrans. Cependant le traitement de la polution n’est pas terminé et de nombreuses questions sont en suspens.
e mazout de l’Erika a depuis longtemps quitté nos écrans. Cependant le traitement de la polution n’est pas terminé et de nombreuses questions sont en suspens.
Tout d’abord on peut s’interroger sur l’efficacité des méthodes proposées par l’État pour solutionner le nettoyage. Les nappes de pétroles n’étaient pas encore arrivées sur les plages que l’événement servit de moyen de propulsion pour quelque député vendéen adepte du show médiatique (une couche de sable, une couche de fioul, un couche de Villiers). Par la suite ce sont quelques ministres qui en profitèrent pour se livrer à de nouvelles querelles (environnement et intérieur).
Alors que les moyens mis en œuvres mirent du temps à être coordonnés par une seule celulle de crise, les structures administratives étant des barières difficiles à franchir, les populations concernées firent preuve d’un dynamisme exemplaire, aidées par des bénévoles venus de toute l’Europe. Une main d'œuvre certe généreuse, mais surtout à bon prix. Les pollutions n’on pas de frontières, la solidarité non plus, preuve, on le souhaiterait, d’une citoyenneté européenne qui s’exprime malgré la toute puissance des marchés. Les pouvoirs publics quant à eux sont à la traine et les citoyens français dans leur ensemble assumeront les frais de la catastrophe. Paradoxe : tandis que les libéraux demandent toujours moins d'État, il est du ressort de ces mêmes États d'assurer la sécurité du secteur privé et multinational, mais aussi d'assumer son irresponsabilité.
Contrairement à ce que beaucoup affirmaient, depuis la catastrophe de l’Amoco Cadiz, un véritable travail a été fait pour prévenir ce genre d’événement. Mais le trafic n’a cessé d’augmenter, tandis que certains déréglements commerciaux le réduisait à néant. La marée noire de l’Amoco ressurgissait elle même, à mesure que l’on retrouvait ça et là dans des décharges sauvages, ses déchets oubliés depuis plus de vingt ans.
La Bretagne s’interroge aujourd’hui sur le devenir de sa saison touristique, comme si le loisir des autres était sa seule raison d’exister. Sa façade maritime permettrait cependant à la France de se hisser au premier rang pour le transport par voie de mer, de peser ainsi sur le commerce mondial et ses réglementations, si une réelle politique existait dans ce sens.
Ce genre d’accident n’est pas une fatalité. Il est la conséquence non pas de la « mondialisation », mais de la dilution des responsabilités jusqu’à leur disparition totale, dans une société où l’argent n’est plus au service de l’humain mais son dieu et maître.
![]()
![]()



