


Didier
Schein
Novembre 1997
article précédent
![]()
Localisation
des populations aroumaines
carte 1
Localisation
des population Istro-roumaines
carte 2
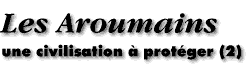
![]() a première partie de cet article consacré aux Aroumains, populations latines des Balkans, est parue dans le numéro 6 en décembre 1996.
a première partie de cet article consacré aux Aroumains, populations latines des Balkans, est parue dans le numéro 6 en décembre 1996.
’histoire des Aroumains au XXe siècle peut se résumer en trois mots correspondant à trois étapes successives : dénationalisation, assimilation et acculturation.
Le combat entrepris au XIXe siècle par les Aroumains pour la reconnaissance de leurs droits nationaux, notamment celui de disposer d’un enseignement, ainsi que d’une liturgie en aroumain dans les églises orthodoxes, reçut alors le soutien du nouvel État roumain. Ce soutien fut à double tranchant : l’enseignement se faisait dans les écoles (la première ouvrit en 1864) en roumain et en aroumain, c’est-à-dire dans une langue étrangère, et le résultat en fut plus une dénationalisation des Aroumains qu’un véritable développement littéraire de leur langue et de leur culture. En 1913, Bucarest renonça à son soutien et les écoles disparurent peu à peu.
La bataille pour le culte en aroumain dans les églises n’eut pas plus de résultat car elle se heurta à la forte opposition nationaliste du clergé grec (on affirmait, par exemple qu’il ne fallait prier le Bon Dieu qu’en grec ou que Dieu n’a besoin de l’aroumain que lorsqu’il parle au Diable). La disparition des écoles, la liturgie dans une langue étrangère, mais aussi l’établissement de frontières nuisant à la libre circulation voulue par la transhumance et l’oubli volontaire dans lequel les États nationaux ont laissé les populations aroumaines ont abouti à une assimilation progressive de celles-ci aux populations majoritaires slaves, albanaise ou grecque.
Depuis les années 80, les Aroumains connaissent une nouvelle forme de perte d’identité, commune à toutes les civilisations rurales. L’exode montagnard et l’attirance vers la ville vont de pair avec la perte des valeurs traditionnelles : une acculturation par l’occidentalisation de la culture. La transhumance se fait rare, l’organisation sociale des falcari a disparu et la famille a adopté la structure nucléaire occidentale. Quant à la langue aroumaine, elle survit difficilement : la nouvelle génération n’en a souvent qu’une connaissance passive, limitée à la seule compréhension et réservée à la famille.
Pourtant les bouleversements survenus ces dernières années avec la chute du communisme et l’indépendance de l’État macédonien, ont poussé à nouveau les Aroumains sur le devant de la scène internationale. Ainsi, les 8500 Aroumains de Macédoine ont obtenu certains droits : émissions hebdomadaires en aroumain à la télévision de Skopje, ainsi qu’aux radios locales de Bitolia (Bitola), Stipa (Stip) et Crusevo (Krusevo)(1), cours de langue et d’histoire aroumaine dans les écoles. En Albanie(2), les Aroumains commencent également à bénéficier de certains droits, notamment dans le domaine de l’enseignement(3). Cependant, en Grèce, là où ils sont les plus nombreux (environ 200 000 personnes parlent l’aroumain et autant l’auraient oublié), les Aroumains ne sont que sujet d’ignorance ou de mépris. Aucune école ne dispose de cours en aroumain, alors que la prédominance de l’enseignement aroumain serait justifié dans le Pinde, au moins à Aminciu (Metzovo) ; l’Église grecque semble toujours considérer le locuteur aroumain, « cette langue infecte et perfide », comme l’envoyé de Satan… La question aroumaine a cependant été posée auprès de la communauté internationale : l’Union Européenne a reconnu l’aroumain comme une langue minoritaire à protéger, au grand dam des Grecs. Le 30 juin 1992, un conseiller du Premier Ministre grec affirmait : « Tous les Grecs ne sont pas Valaques, mais tous les Valaques sont Grecs ! »
Les mouvements aroumains connaissent un fort regain actuellement, notamment depuis l’entrée de la Grèce dans la Communauté Européenne en 1985. En Grèce, Albanie et Macédoine, des associations aroumaines se créent. La diaspora aroumaine fait entendre sa voix auprès des institutions internationales, notamment grâce à l’association internationale Unirea tra Limba si Cultura Aromâna (L’Union pour la Langue et la Culture Aroumaine). Des revues aroumaines sont publiées aux USA, en Allemagne et à Paris. Une maison d’édition aroumaine, Cartea aromâneasca (Le Livre aroumain), existe à Syracuse (Etats-Unis). Toutes les revendications nationales des Aroumains, précisons-le, sont pacifiques : elles ne concernent que le droit à la langue et à la culture.
Alors, on se prend à espérer que, dans les négociations gréco-macédoniennes, la parole soit laissée aux Aroumains. Et qu’on aille ensuite vers un règlement global des différends de la région, en englobant aussi l’Albanie dans les pourparlers. La chance, à long terme, pour les Aroumains, passerait peut-être par un élargissement de l’Union Européenne aux Balkans et par une régionalisation. Mais il faudra du temps. En attendant, le mouvement aroumain, aussi actif et volontaire soit-il, ne dispose que de peu de moyens pour se faire entendre. Mais même s’il ne serait qu’un sursaut, le chant du cygne d’une culture déjà condamnée par l’Histoire (avec un grand «H», celle qui ne fait pas dans les particularismes), ne serait-ce que par respect pour une civilisation qui a tant apporté à cette partie de l’Europe (et qui continue à se manifester avec la plus grande sagesse), et pour qu’un jour les touristes ne débarquent pas à Aminciu (Metzovon) comme s’ils iraient visiter une réserve indienne ; le combat pour la culture et la langue aroumaines doit être mené. Dans une génération, il sera trop tard.
Didier SCHEIN
Notes :
1. Nous avons privilégié pour la toponymie les noms aroumains. Entre parenthèses figure le nom officiel actuel.
2. Les chiffres des populations aroumaines en Albanie ne sont pas disponibles. Cependant l’association aroumaine Areminili din Albani affirme que les Aroumains forment la première minorité nationale, avant les Grecs, ce qui ferait plus de 60 000 personnes.
3. Une école pluriculturelle s’est ouverte en septembre 1996 à Arghirocastru (Gjirokastër, Albanie) dans laquelle les cours sont dispensés en quatre langues : albanais, aroumain, grec et tzigane (cf. « Le CEAVA, un réseau associatif à l’échelle du continent », L’Un [EST] L’Autre n°5, septembre 1996).
![]()
![]()



